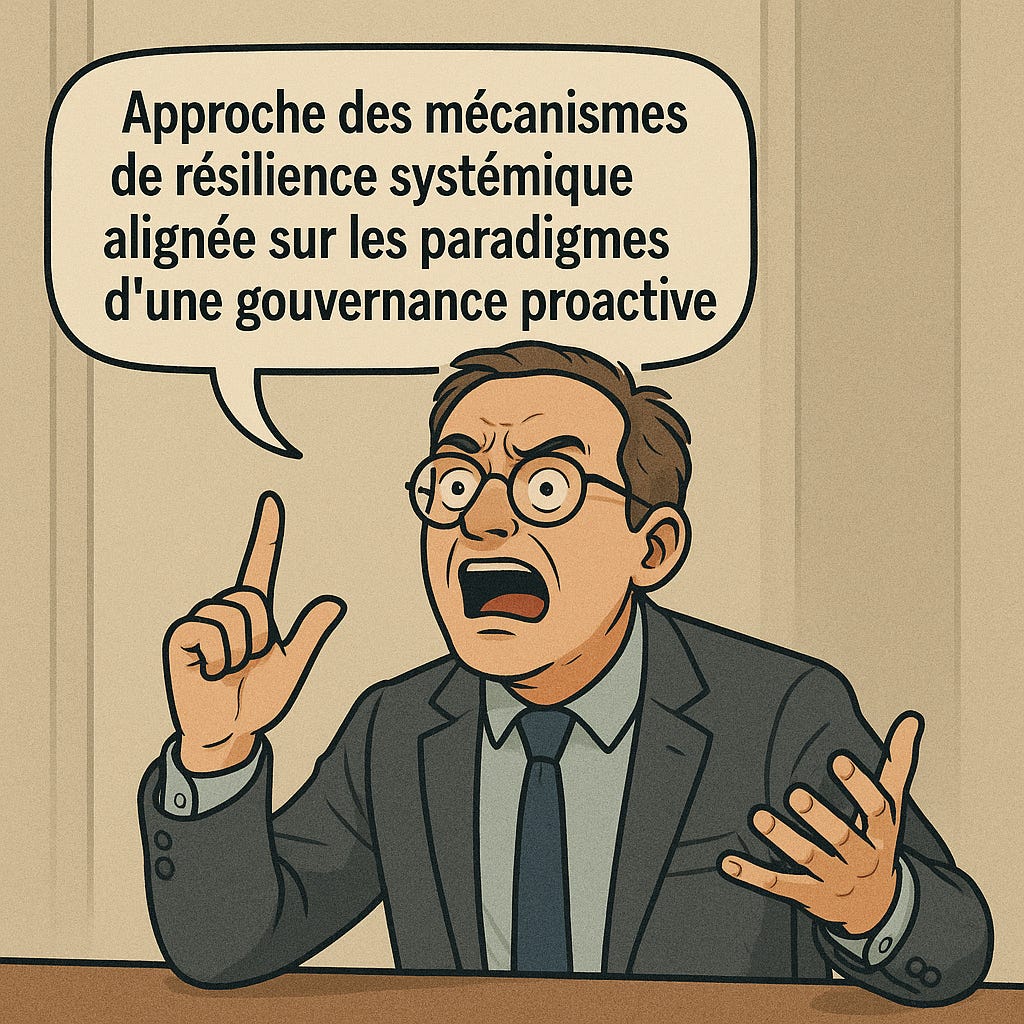Les vacances d’été approchent, chères lectrices et lecteurs, et, avec elles, l’échéance d’un engagement personnel. Organisation oblige, et parce que je commence à légèrement manquer d’inspiration, les mois de juillet et août me verront déroger au rythme de publication hebdomadaire tenu depuis plus de 3 mois! On se retrouvera en septembre. 😇 Mais, ne vous inquiétez pas, on finit cette saison avec “du lourd”…
Opérationnel & Métiers & Logorrohée conceptualisatrice
Après vous avoir proposé la définition de l’omni-préfixe “cyber”, place à trois nouvelles définitions de terme dits “alibi”, c’est à dire de ceux que certains invoquent, au petit bonheur la chance, au gré de leurs interventions orales, sans jamais s’interroger sur leur sens véritable.
Opérationnel (omni-adjectif) : en cybersécurité, tout est “opérationnel” ; cela n’est pas entendu au sens où tout fonctionnerait bien, où tous les systèmes seraient “opérationnels” ; non, “opérationnel” est ce que l’on pourrait appeler un adjectif d’autorité, en ce qu’on le place à toutes les sauces, pour se prévaloir d’une dimension technique qui peut parfois (souvent?) être parfaitement absente.
Synonyme adjectival de l’acte d’autorité, le terme “opérationnel” permet à quiconque de se targuer d’expertise sans avoir à prouver qu’il ou elle a déjà mis les mains dans une console.
C’est aussi l’adjectif de secours du manager en mal de contenu technique : on ne dit plus “ça avance”, mais “ça avance sur le plan opérationnel”, ce qui donne à une stagnation molle les allures d’une percée tactique.
On parlera ainsi de “plan opérationnel” pour désigner un tableur déstructuré ; de “mesure opérationnelle” pour un blocage d’IP fait à la main à 2h du matin ; ou encore d’“équipe opérationnelle” pour qualifier trois stagiaires, un alternant et un prestataire en burnout.
Enfin, c’est le tampon linguistique qui permet de conclure n’importe quel audit en concluant que tout n’est pas parfait, mais le dispositif a le mérite d’être opérationnel, c’est-à-dire : “on n’a rien compris, mais ça n’a pas encore explosé en vol”.
Le second terme est beaucoup plus flou, et donc encore plus employé en milieu professionnel :
Métiers (nom masculin pluriel, peuplade conceptuelle mythifiée) : en cybersécurité et plus encore dans le monde numérique moderne, “les métiers” désignent une ethnie fictive, invoquée à tout propos mais rarement consultée. Figure totémique des débats stratégiques, les métiers ne parlent pas d’une seule voix, mais cela n’empêche personne de prétendre s’exprimer en leur nom.
On leur attribue des désirs, des craintes, des besoins ; souvent contradictoires, mais toujours pratiques pour orienter une décision déjà prise : “les métiers ne veulent pas de double authentification”, “les métiers ont besoin de plus de confort”, “les métiers sont très sensibilisés à la cybersécurité” (personne n’a jamais rencontré ces métiers-là, mais ils existent, promis).
Entité insaisissable et Pythie des temps modernes, les métiers servent aussi de bouclier argumentatif diplomatique : quand un projet est bancal, on dira qu’il est “demandé par les métiers”, façon polie de dire “ne m’accusez pas, je ne fais qu’obéir à un oracle invisible”.
Tout comme on ne questionne pas les traditions d’un peuple ancien, on n’interroge pas les métiers : s’ils veulent un accès admin à tout le SI, c’est sûrement pour une bonne raison. S’ils envoient des fichiers sensibles par WeTransfer, c’est “leur réalité terrain”. Et s’ils refusent une formation, c’est parce que “ça ne correspond pas à leurs usages”.
Ainsi vivent “les métiers”, tribu omnipotente, dotée d’un pouvoir consultatif unilatéral, et dont la culture est essentiellement reconstruite à travers les fantasmes de ceux qui ont besoin d’une justification.
Enfin, petit bonus final, un concept trop souvent éprouvé en présence de commerciaux se croyant très subtils, ou de chefs à plume en mal d’activité :
Logorrhée conceptualisatrice (locution nominale féminine, concept capitalo-ironique) : en cybersécurité, il est fréquent que des acteurs se sentent peu à l’aise ; la complexité intrinsèque de certains sujets, combinée à la frustration (mal placée) à ne pas les comprendre dans le détail, donne naissance à des stratégies dont l’objectif est de dissimuler son mal-être… et c’est alors que le pire peut arriver. Ce pire, est la logorrhée conceptualisatrice ; elle consiste en la production d’un flot continu de phrases et mots qui ont, de prime abord, l’apparence de la vraisemblance et de la raison, mais qui après examen se révèlent n’être que du charabia intellectualisant. Parfois, le locuteur semble lui-même subir sa propre excrétion verbale ; son regard, apeuré, hurle le dégoût de soi et la haine de sa propre bouche. Dans d’autres occasions, plus dangereuses, le diarrhéique se croit touché par la grâce, et est intimement persuadé d’être en train de révolutionner une discipline intellectuelle et de vivre un moment fort de sa vie professionnelle. A noter qu’il ne faut pas lutter contre de tels “maux de ventre verbaux” ; ils ont, en général, le mérite de ne blesser personne directement ; cependant, empêchez l’un de ces malades d’évacuer son trop-plein bucal, et vous pourriez bien vous retrouver la cible de sa prochaine crise de foie mentale.
Comme d’habitude, je suis preneur de retours, commentaires, critiques, suggestions! Et n’hésitez pas à exploiter les semaines qui s’annoncent pour permettre une rentrée “en fanfare” du Dictionnaire ironique de la cybersécurité! 😈
A tchao bon lundi!